
Coûts, manque de terminaux, besoins fonciers : lors du colloque de l’ORT&L du 11 mars 2025, Egger, Tepsa et MGE ont partagé les défis concrets auxquels le report modal doit faire face dans notre région. Pour les entreprises, expérimenter et bâtir des partenariats sont des leviers clés afin de construire des chaînes logistiques plus durables sans compromettre leur compétitivité.
« Nous avons du mal, en France, à développer des transports alternatifs à la route » : tel est le constat implacable dressé par Jochen Schüler. Le directeur logistique du groupe autrichien Egger, spécialisé dans la transformation du bois pour le bâtiment (mobilier, sols, construction), intervenait lors d’une table ronde sur le report modal, à l’occasion du colloque sur la décarbonation des transports organisé par l’ORT&L Grand Est à Pont-à-Mousson le 11 mars 2025. « Dans d’autres pays le taux de report modal peut atteindre 30 %, voire 50 %. » a-t-il déploré.
Les modes massifiés, une nécessité pour certaines chaînes logistiques
Pour autant, certaines filières ont recours, de longue date, aux modes de transports massifiés et ont construit leur logistique autour du ferroviaire ou du fluvial. C’est le cas notamment de la société Tepsa spécialisée dans le stockage et la logistique de carburants et de produits chimiques et agricoles liquides. « La massification est l’essence même de notre métier ; c’est le moteur indispensable à notre activité » affirme non sans humour Stéphane Simon, directeur des terminaux à Tepsa France présent en particulier sur le port de Strasbourg. « Le terminal, sans cette massification, perd son avantage stratégique et le territoire perd un stockage au plus près de la consommation. » La logistique des carburants nécessite en effet des modes massifiés, maritime et fluvial, ainsi que des stockages massifiés comme ceux présents sur le port de Strasbourg. La recharge sur camion permet ensuite, via des hubs bien répartis sur le territoire, l’alimentation des stations-services.
Le rail, en revanche, fait figure de « parent pauvre de la multimodalité » dans le domaine des carburants selon Stéphane Simon. Cela s’explique par la présence historiquement des dépôts d’hydrocarbures dans les ports maritimes ou fluviaux. « Les wagons citernes pour produits dangereux sont peu nombreux, constate-t-il. Il s’agit de flottes captives, faisant toujours le même trajet. Aucun wagon ne serait disponible pour le lancement éventuel d’un nouveau transport. »
Solidifier les coopérations dans la durée
Pour les filières et les acteurs qui n’utilisent pas les modes massifiés, construire des solutions logistiques intégrant le fluvial ou le ferroviaire peut représenter un changement important des modes de fonctionnement. D’où l’importance de s’entourer de partenaires spécialisés ou ayant déjà une certaine expérience dans le domaine. Parfois même des acteurs historiques du transport routier qui ont fait le choix de compléter leurs services par des offres multimodales.
Tel est le cas du groupe MGE, basé près d’Épinal (le « E » de MGE), qui a lancé des essais de report modal pour son voisin vosgien Egger dont l’usine se trouve à Rambervillers. « La clé pour qu’un prestataire de service réussisse dans sa stratégie d’offre de transport intermodal, c’est qu’il ait des industriels donneurs d’ordres qui lui fassent confiance et aient envie de franchir le pas, souligne Philippe Virtel, président de MGE. Le report modal n’est pas simple à mettre en œuvre. Il faut de l’engagement et de la confiance vis-à-vis du prestataire : l’industriel ne doit pas rester dans la logique de l’appel d’offres et de la consultation systématique, mais solidifier des projets et des coopérations au fil du temps. »
Peu de terminaux rail-route pour le transport combiné continental
 Groupe familial exploitant 520 ensembles routiers, MGE s’est lancé il y a 15 ans dans le transport combiné rail-route avec deux lignes, entre Rennes et Mâcon et entre Champigneulles et Fos-sur-Mer. « C’était un évènement à l’époque quand un transporteur routier lançait une ligne ferroviaire de transport combiné, rappelle Philippe Virtel. Nous avons ainsi contribué à la renaissance du terminal multimodal de Champigneulles, qui est aujourd’hui le seul terminal rail-route qui traite des caisses mobiles de transport combiné en région Grand Est. Aujourd’hui, sur Reims, il n’y a aucune possibilité de faire du report modal en combiné rail-route. À Strasbourg, il y a un terminal très orienté vers les conteneurs maritimes mais qui ne sait malheureusement plus traiter les caisses mobiles 45 pieds pour du transport continental. Seul le Nouveau port de Metz pourrait être un site de report modal pour les caisses mobiles. »
Groupe familial exploitant 520 ensembles routiers, MGE s’est lancé il y a 15 ans dans le transport combiné rail-route avec deux lignes, entre Rennes et Mâcon et entre Champigneulles et Fos-sur-Mer. « C’était un évènement à l’époque quand un transporteur routier lançait une ligne ferroviaire de transport combiné, rappelle Philippe Virtel. Nous avons ainsi contribué à la renaissance du terminal multimodal de Champigneulles, qui est aujourd’hui le seul terminal rail-route qui traite des caisses mobiles de transport combiné en région Grand Est. Aujourd’hui, sur Reims, il n’y a aucune possibilité de faire du report modal en combiné rail-route. À Strasbourg, il y a un terminal très orienté vers les conteneurs maritimes mais qui ne sait malheureusement plus traiter les caisses mobiles 45 pieds pour du transport continental. Seul le Nouveau port de Metz pourrait être un site de report modal pour les caisses mobiles. »
Afin de promouvoir le report modal vis-à-vis de ses clients, MGE a créé il y a deux ans une filiale, MGE Intermodal, qui identifie au sein du fond de commerce de MGE les flux qu’il est possible de reporter sur des modes alternatifs à la route, et conçoit les schémas favorables à un abandon durable et massif du transport intégralement routier par ces industriels au profit du ferroviaire.
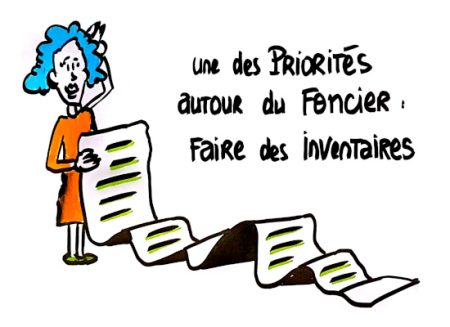 Le foncier, un enjeu clé pour le report modal
Le foncier, un enjeu clé pour le report modal
Un des premiers freins au report modal est de disposer d’un foncier adapté. C’est d’ailleurs aussi le cas pour la transition énergétique des convois routiers. Ainsi, sur son plus gros site, à Chavelot (au nord d’Épinal), MGE a le projet de développer à partir de la fin de l’année une flotte de tracteurs routiers électriques. Une surface a été réservée sur le site pour permettre la construction de 30 postes de charge en simultané pour des camions électriques.
Élément crucial pour décarboner les flottes, le foncier l’est encore plus pour le report modal vers le ferroviaire. « Pour construire des terminaux, il faut des hectares de terrain plat, bénéficiant de permis d’aménager et situés non loin de grandes voiries routières et de lignes ferroviaires circulées H24, détaille Philippe Virtel. Ce sujet devrait devenir un sujet politique, car la capacité à aménager du foncier de manière très rapide est une des clés du report modal. »
Il plaide pour que les collectivités qui possèdent des terrains en bordure des grands axes ferroviaires portent une étude : « Il s’agirait de savoir quels terrains se prêtent à la création, ex nihilo, d’embranchements ferroviaires. Une fois que cet inventaire est fait, il faudra que le législateur autorise l’accélération des procédures administratives, car il s’agit d’un enjeu écologique et générationnel. La vitesse d’exécution des procédures doit être à la hauteur de la vitesse à laquelle on impose aux transporteurs de décarboner leur offre de transport ! »
Expérimenter pour avancer
Une affirmation qui ne sera pas contredite par Jochen Schüler, qui rappelle sa première déconvenue lorsqu’il a voulu passer au mode ferroviaire pour une partie des transports du groupe Egger dans la région : « Nous avons déjà raté le train une première fois en 2022. Nous aurions alors fait un report modal très important dans les Vosges si nous avions eu un embranchement ferroviaire. Cela nous conforte dans notre décision de faire des expérimentations avec le monde intermodal, pour comprendre les contraintes de délai et de régularité qui sont celles du ferroviaire. »
Au-delà du foncier, la question du surcoût est un frein majeur pour la décarbonation du transport routier et le recours au fret ferroviaire et au fluvial. Philippe Virtel conclut la table ronde en mettant l’accent sur l’importance d’avoir une fiscalité qui favorise la décarbonation du fret et le report modal, en particulier dans les projets de péages poids lourds portés par la Région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace (voir nos articles), le dirigeant de MGE plaidant pour une exemption pour les camions décarbonés ou ceux effectuant des pré- ou post-acheminements dans le cadre d’un transport combiné rail-route ou fleuve-port.









